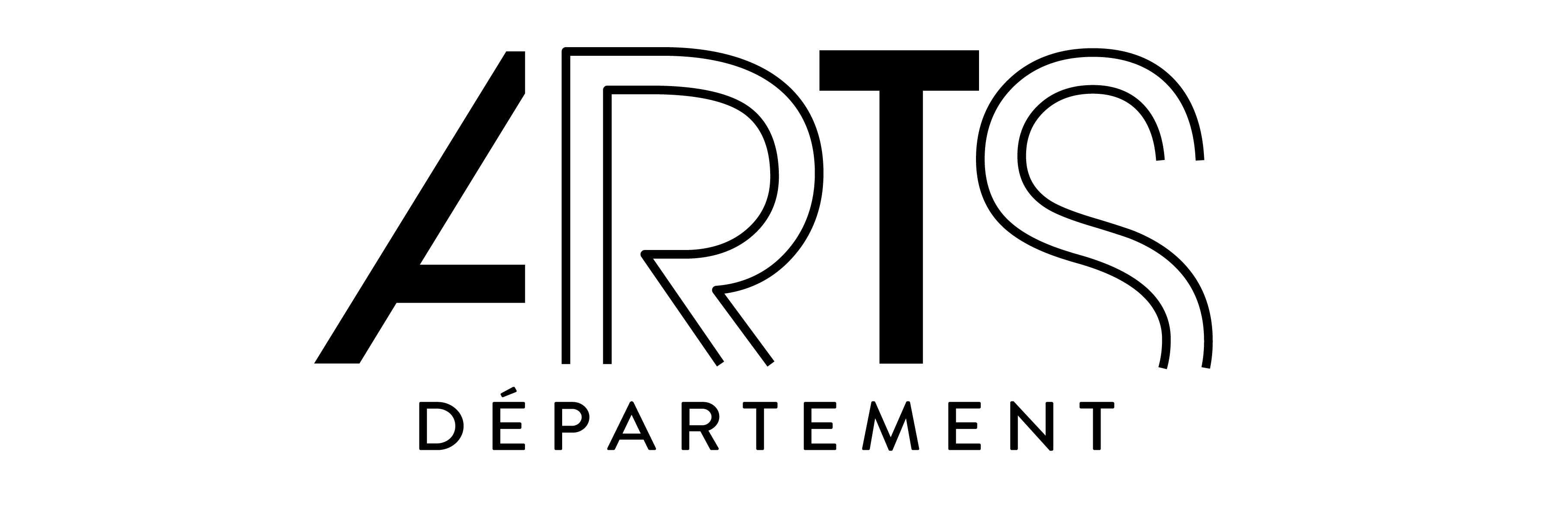S1 - Cours et Séminaires par discipline 2024-2025

- Etudes cinématographiques
- Histoire de l’art
- Musique
- Etudes théâtrales
- Esthétique et philosophie de l’art
- Photographie
|
Etudes cinématographiques
|
|||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
| Joseph von Sternberg, de Vienne au Japon en passant par Hollywood | |||||
|
Françoise Zamour et |
LUNDI 14H–16H |
Salle Weil | 6 | S1 | Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIERE SEANCE : le 16 septembre 2024. Joseph von Sternberg (1894-1969) est surtout connu pour la série de 8 films dans lesquels il a dirigé Marlène Dietrich, dont les 2 versions de L’Ange bleu et Cœurs brûlés (Morocco), qui ont fait d’elle une star internationale et la rivale de Greta Garbo. Ballotté entre Vienne et New York, autodidacte, Sternberg s’est imposé dès le muet comme un véritable auteur, un cinéaste pictorialiste et perfectionniste, créateur, par le biais des décors, de la lumière et du montage, d’atmosphères aussi reconnaissables que variées, qu’elles soient exotiques (le Maroc, la Chine de Shanghai Express et de The Shanghai Gesture, la Russie de Crépuscule de gloire et de L’Impératrice rouge, l’Espagne de La Femme et le Pantin) ou réalistes (The Salvation Hunters, Les Damnés de l’Océan, Une tragédie américaine). Sa carrière singulière, combinant projets personnels et films de studios (avant tout la Paramount), l’a amené à travailler à Hollywood, mais aussi à Berlin, à Londres et à Kyoto, à diriger de nombreuses stars (Emil Jannings, Gary Cooper, Sylvia Sidney, Cary Grant, Peter Lorre, Charles Laughton…) et à collaborer (ou à entrer en conflit) avec Stroheim et Eisenstein, Chaplin et King Vidor, Selznick et Korda, Dreiser et Dos Passos… Validation : intervention orale sur un film, ou sur un aspect spécifique de l’œuvre de Von Sternberg. |
|||||
|
Séminaire d’analyse de films |
|||||
|
Françoise Zamour |
VENDREDI 14H–17H |
27/09, 04/10 et 11/10 : salle des Actes 18/10 : Amphi Galois 25/10 : salle des Actes 08/11 : salle Berthier (29, rue d’Ulm) 15/11, 22/11 et 29/11 : salle des Actes 13/12 : salle Marbo 20/12 : salle Borel |
6 | S1 | Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIERE SEANCE : le 27 septembre 2024. Une approche à travers l’analyse précise des cinématographies les plus diverses. Le cours s’adresse à tous les publics, spécialisés ou non dans le cinéma. Il implique une participation active en cours et la rédaction de travaux au cours du semestre. Validation : deux analyses écrites minimum au cours du semestre. |
|||||
|
Retours à la Nouvelle Vague : autres pistes, nouveaux regards |
|||||
|
Antoine de Baecque |
JEUDI 10H30 -12H30 |
|
6 | S1 |
Master et doctorat |
|
CALENDRIER des salles : Il ne faut pas laisser le cinéma de la Nouvelle Vague figé dans une légende. Depuis deux décennies, de nouvelles approches permettent de redessiner le renouveau du cinéma, en France et dans le monde, de la fin des années 1950 à 1968. De nombreuses archives sont désormais accessibles, et les perspectives biographiques, féministes, politiques, internationales, permettent d’ouvrir à nouveau frais ce dossier qu’on pouvait croire rangé une fois pour touts dans le panthéon du cinéma français. |
|||||
|
Deleuze et ses films |
|||||
|
Antoine de Baecque |
UN LUNDI/MOIS 14H - 16H30 |
Amphi du Mûrier (Beaux-Arts) 14 rue Bonaparte 75006 |
6 | S1/S2 (insécables) |
Master et doctorat |
|
CALENDRIER : donné à la rentrée. Les deux volumes écrits par Gilles Deleuze, L’image-mouvement et L’image-temps, regorgent de films vus, de films aimés, de films décrits, de films tremplins vers les concepts, parfois les plus divers,intrigants, excentriques. Le philosophe fait feu de tout bois et celaprécisément car il est cinéphile, ayant vu beaucoup de films, s’appuyantsur leur analyse de détail. Ce séminaire propose une relecture desécrits de Deleuze via les films et leurs interprétations. |
|||||
|
Séminaire de tutorat : Actualité du cinéma |
|||||
|
Françoise Zamour et |
UN JEUDI/MOIS 13H - 15H |
Salle Weil | 3/S |
S1/S2 |
Tutorat |
|
Réservé aux élèves et étudiants inscrits en cinéma (inscription principale ou secondaire), ou dont les travaux de recherche concernent le cinéma. CALENDRIER du S1 : 3 octobre, 7 novembre, 12 décembre et 16 janvier. Validation : parcipation assidue et active à toutes les séances. Animation d’au moins une discussion par semestre. |
|||||
|
La Critique. Séminaire de l’Institut d’Études Critiques |
|||||
|
Antoine de Baecque |
UN MERCREDI/MOIS 18H - 20H |
INHA 6 rue des Petits Champs 75002 |
6 | S1/S2 (insécables) |
Avancé |
| Animé par Antoine de Baecque et programme d’invités à venir.
Ce séminaire interdisciplinaire s’interroge sur les divers modes de l’écriture et de l’intervention critique, en France et à l’étranger. A travers l’étude de certaines personnalités, certaines revues ou journaux, certains lieux, certains courants de la critique cinématographique, on verra comment peut s’opérer de manière singulière et précise la transmission d’une expérience. |
|||||
| Histoire de l’art | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
|
Cours méthodique d’histoire de l’art – XIXe et XXe siècles |
|||||
|
Katia Sowels |
14H - 16H30 |
À l’extérieur (Musée d’Orsay, Centre Pompidou) |
6 | S1 | Initiation Recommandé aux 1e année /préparation INP |
|
PREMIERE SEANCE : le 2 octobre 2024. Ce cours, pérenne depuis des années, vise à une initiation, « méthodique » comme l’indique le titre, d’étudiant.es qui n’ont pas une culture préalable en histoire de l’art. Les étudiant.es de première année, celles et ceux venus des d’autres disciplines que l’histoire de l’art, y compris des disciplines relevant des sciences exactes, sont les bienvenus. Mais les normaliens qui commencent à préparer le concours de conservateur du patrimoine y trouvent en général aussi leur compte, à cause du spectre chronologique large qu’il embrasse. Ce semestre, et à raison d’une semaine sur deux, le cours proposera un parcours au sein des collections d’art des XIXe et XXe siècles du Musée d’Orsay et du Musée National d’art moderne – Centre Pompidou, par une approche qui privilégie d’abord le regard sur les œuvres elles-mêmes. Validation : devoir écrit (commentaire d’œuvre). |
|||||
| L’histoire de l’art et ses catégories : approches critiques | |||||
|
Charlotte Guichard |
MERCREDI 10H30 - 12H30 |
Salle Cavaillès |
6 | S1 |
Initiation |
|
PREMIER COURS : le 18 septembre 2024 en salle Conf 46. Ce séminaire interroge les catégories de l’histoire de l’art, telles que l’historiographie en témoigne, dans ses concepts et ses problèmes. On présentera la constitution des catégories classiques de l’histoire de l’art depuis Vasari et la Renaissance, mais aussi le moment décisif de la Kunstwissenschaft autour de 1900. Parce que l’histoire de l’art est une discipline vivante, en prise avec le contemporain, le séminaire reviendra aussi sur la manière dont elle s’est emparée de catégories émergentes, venues des sciences sociales. La lecture critique de ces textes fondateurs sera articulée à des analyses d’œuvres majeures du canon, depuis le quinzième siècle, renouvelées par les problématiques plus actuelles. Certaines séances sont prévues au musée du Louvre. Validation : assiduité, participation, note critique. |
|||||
|
Le surréalisme d’abord et toujours ! |
|||||
|
Katia Sowels |
MARDI 8H30 - 10H30 |
salle des Actes : 17/09, 8/10, 19/11, 3/12, 17/12 Salle Paul Langevin (29, rue d’Ulm) : 24/9, 1/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 10/12 |
6 | S1 | Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIERE SEANCE : le 17 septembre 2024. Dans les musées et les galeries, en France et à l’international, l’automne 2024 sera marqué par les célébrations du centenaire du surréalisme. S’agit-il uniquement de commémorations ou le mouvement dispose-t-il d’une actualité avérée ? Que retenir du surréalisme, cent ans après la publication de son premier Manifeste ? Comment l’exposer aujourd’hui ? Ce cours sera conçu autour de l’exposition rétrospective « Le surréalisme d’abord et toujours ! » organisée pour l’occasion par le Centre Pompidou (à partir de visites et par l’étude des œuvres du catalogue). Des années 1920 aux années 1960, et à travers des géographies plurielles, il présentera quelques jalons de la trajectoire poétique, artistique et politique du mouvement, qu’André Breton a résumée par cette formule restée célèbre : « ‘Transformer le monde’, a dit Marx ; ‘Changer la vie’, a dit Rimbaud : ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un. » Ce cours interrogera la persistance, le renouvellement et l’actualité des créations, des pratiques et des engagements du surréalisme (antimilitarisme, antinationalisme, anticolonialisme, etc.), ainsi que son héritage artistique et culturel, dans une chronologie élargie et en dialogue avec des œuvres plus récentes. Il examinera en outre les initiatives scientifiques et institutionnelles en cours pour valoriser son histoire dans une perspective inclusive, internationale et transculturelle. Validation : mini-mémoire. |
|||||
|
Sur les ruines des musées ? Collections muséales, provenances, et nouveaux partages. |
|||||
|
Charlotte Guichard |
MARDI 10H30 - 12H30 |
salle des Actes : 17/09, 8/10, 19/11, 3/12, 17/12 Salle Paul Langevin (29, rue d’Ulm) : 24/9, 1/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 10/12 |
6 | S1 | Initiation/ Avancé |
|
PREMIER COURS : le 17 septembre 2024. En 1995, le critique et historien de l’art Douglas Crimp évoquait dans un article devenu fameux « les ruines des musées ». Un tel retour critique sur l’institution muséale est devenu incontournable aujourd’hui, dans un contexte marqué en particulier par la crise d’autorité des musées occidentaux à visée universaliste, alors même que les musées attirent des foules toujours plus nombreuses et que leur architecture s’est imposée dans les espaces urbains. Loin d’être un lieu neutre, le musée est un espace qui produit des récits, propose une histoire et des mémoires. Le séminaire propose de revenir sur les débats qui agitent le monde des musées autour de grandes questions d’actualité (restitutions, décolonisation des collections et des images, statut des réserves muséales). Il reviendra sur l’histoire des collections des musées encyclopédiques nés au dix-huitième siècle à partir de quelques cas d’études (British Museum, Musée du Louvre, île des Musées à Berlin) et présentera les nouveaux enjeux qui se présentent pour les musées d’ethnographie, les musées d’art ou de science dans un contexte de brouillage des frontières — instituées par la pensée des Lumières — entre nature et culture, entre art et science. Validation : assiduité, lecture des articles préliminaires à chaque séance et mini-mémoire (collectif). |
|||||
|
Séminaire de Tutorat |
|||||
|
Charlotte Guichard |
UN MARDI/MOIS 14H - 16H (Sauf le 08/10 : 14h30 / 16h30) |
Salle Weil | 6/S |
S1/S2 (insécables) |
Tutorat/ préparation INP |
|
PREMIERE SEANCE :le 24 septembre 2024. Ce séminaire est réservé aux étudiant·es spécialistes d’histoire de l’art pour lesquels il est obligatoire. On y alternera lectures de textes, questions d’actualité, et enfin, pour les étudiant·es concernés, une préparation aux épreuves de l’INP. Les étudiant·es sont appelés à se saisir de ces séances, c’est-à-dire à y parler, débattre autour de sujets proposés en début de semestre. Validation : La validation du cours dépend de la participation effective de chaque étudiant·e. |
|||||
|
Séminaire Autochtonie, hybridité, anthropophagie (5) |
|||||
|
Morgan Labar et |
UN MERCREDI 17H - 19H30 |
Salle Weil | 3 | S1/S2 (insécables) |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIER COURS S1 : 25 septembre 2024. Cette année le séminaire poursuit l’étude des arts contemporains autochtones en contexte globalisé. Les termes « autochtonie », « hybridité » et « anthropophagie » (en référence au Manifeste Anthropophage d’Oswald de Andrade publié en 1928) sont accolés afin de questionner les assignations identitaires et les essentialismes, et d’interroger l’invention de pratiques et d’identités fluides, déjouant les catégories héritées du colonialisme et permettant de repenser les rapports à la nature, au territoire, aux autres humains et aux autres qu’humains. Validation : participation et présentation orale d’un article ou chapitre d’ouvrage. |
|||||
|
Structuralisme et esthétiques du terrestre |
|||||
|
Patrice Maniglier (Nanterre) et Jeanne Etelain (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier) |
MERCREDI 18H - 20H |
Salle Weil / |
6 |
S1/S2 |
Ouvert à tou.te.s |
|
CALENDRIER : Le structuralisme a sa place dans notre situation intellectuelle, non pas comme héritage passif, mais fait récurrent dont l’énigme mérite d’être interrogée encore de nos jours. Il s’agit d’explorer toutes les ressources et potentialités actuelles du structuralisme, notamment dans les domaines esthétiques et artistiques, en rapport avec notre "présent terrestre". |
|||||
| Musique | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
| Introduction à l’histoire de la musique par l’écoute des œuvres | |||||
| Karol Beffa |
MERCREDI 17H - 19H |
Actes sauf 18 et 25/9 16 et 23/10 6, 13 et 20/11 5/3 en Conf46 |
6/S | S1/S2 (sécables) |
Initiation/ avancé |
|
PREMIERE SEANCE : le 18 septembre 2024. Ce séminaire est ouvert aussi bien aux non-spécialistes, donc aux étudiants et élèves de première année, qu’aux spécialistes, plus avancés dans leurs études. La période étudiée va de Bach à nos jours. Il s’agira essentiellement de musique occidentale savante, mais il sera fait ponctuellement référence à des musiques extra-européennes. Il constitue par ailleurs une préparation à l’épreuve de commentaire d’écoute du concours d’entrée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en classes d’érudition (esthétique, culture musicale, analyse, histoire de la musique). Validation : participation et exposé. |
|||||
|
La musique en France de 1870 à 1940 |
|||||
|
Karol Beffa |
MERCREDI 14H30 - 16H30 |
Salle de musique 46 rue d’Ulm |
6 |
S1 |
Initiation/ |
| PREMIERE SEANCE : le 18 septembre 2024.
Entre 1870 et 1940, la vie musicale en France connaît une période de splendeur inégalée. Alors que décline le romantisme de figures comme Berlioz ou Alkan, Franck, Saint-Saëns, Bizet, Chabrier, Fauré, Chausson, Debussy, Dukas, Ravel et Satie portent la musique française à son apogée. Paris devient alors un pôle d’attraction pour les musiciens du monde entier. |
|||||
| Musique et poésie : le Lied | |||||
| Fériel Kaddour |
JEUDI 14H - 17H |
Salle Conférence 46 | 6 |
S1 |
Initiation/ |
|
PREMIERE SEANCE : le 19 septembre 2024. Le 19 octobre 1814, Schubert compose un Lied sur un poème de Goethe : Gretchen am Spinnrade (Marguerite au rouet). Son manuscrit est intact : aucune rature, aucune correction. L’immédiateté de l’inspiration a longtemps nourri le commentaire musicologique. Schubert aurait inauguré le genre en partageant avec le poème une même « sensibilité exacerbée » et aurait ainsi ouvert la voie d’un nouvel intimisme musical. Validation : mini-mémoire. |
|||||
|
Perspectives musicologiques |
|||||
|
Fériel Kaddour et |
JEUDI 18H - 19H30 |
Salle Musique 46 |
6/S |
S1/S2 (sécables) |
Initiation/ |
|
PREMIERE SEANCE : le 26 septembre 2024. Qu’est-ce que la recherche en musicologie ? La discipline est diverse et se prête à des méthodes de travail contrastées. Ce séminaire tentera d’en offrir un panorama aussi large que possible, en s’ouvrant notamment à des questions et à des répertoires peu abordés par les autres enseignements musicologiques du Département (musique ancienne, musiques actuelles, histoire des institutions culturelles, sound studies, etc.). Certaines séances seront consacrées à des questions spécifiques de méthode. Les quatre dernières séances du séminaire seront consacrées à la lecture de textes de la New Musicology et auront lieu en anglais. Validation : mini-mémoire et participation orale. Les travaux écrits sont à rendre au plus tard le 15 janvier. |
|||||
|
L’interprétation musicale : pratique et théorie |
|||||
|
Fériel Kaddour |
VENDREDI 14H - 18H |
Salle Conférence 46 | 6 | S1/S2 (insécables) |
Initiation/ avancé |
|
PREMIERE SEANCE : le 27 septembre 2024. Ce séminaire propose d’allier pratique et théorie, et plus encore de réfléchir aux apports possibles de la recherche-création dans le domaine musical. Chaque séance sera consacrée à deux œuvres (même effectif, même type formel ou même période de composition), qui seront jouées par des étudiant.e.s. et qui donneront lieu à un cours d’interprétation. Le travail mené à l’instrument sera l’occasion d’une analyse approfondie des partitions, ainsi que d’une réflexion plus générale sur l’interprétation musicale. Les œuvres des deux premières séances seront jouées par d’ancien.ne.s élèves du Département. Les séances suivantes seront consacrées aux propositions des participant.e.s du séminaire. Il n’est cependant pas nécessaire de contribuer musicalement au séminaire pour s’y inscrire : les cours d’interprétation s’organiseront en fonction des propositions des participant.e.s. Pré-requis : lecture d’une partition. |
|||||
|
Musicologie pour spécialistes : analyse, esthétique |
|||||
|
Fériel Kaddour |
VENDREDI 9H30 - 12H30 |
-Conférence 46 : du 20/09 au 11/10 |
6/S |
S1/S2 |
Avancé |
|
PREMIERE SEANCE : le 20 septembre 2024 en salle Conf 46. Réservé en priorité aux musicologues spécialistes, ce séminaire a pour but l’acquisition d’une connaissance tant technique qu’esthétique des styles « classique » (Mozart, Haydn, Beethoven) et « romantique » (Schubert, Schumann, Chopin). Il s’ouvre ponctuellement à d’autres répertoires, ainsi qu’à des problématiques issues de la théorie critique (Adorno) et de la New Musicology. Ce séminaire est également ouvert aux étudiant.e.s spécialistes d’autres disciplines qui souhaitent intégrer la musicologie dans leur parcours d’études. Pré-requis : très bon niveau de solfège et bases solides d’analyse musicale. |
|||||
| Etudes théâtrales | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
|
Le théâtre contemporain est illisible ? Lisons-le ! |
|||||
| Marion Chénetier-Alev |
LUNDI 10H30 - 12H30 |
Salle Weil | 6 | S1 |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIER COURS : le 23 septembre 2024. Alternant lectures de textes contemporains exemplaires, rencontres avec des auteurs dramatiques et tentatives d’appropriation libre des différentes œuvres analysées, ce séminaire propose une plongée dans les écritures théâtrales d’aujourd’hui. Quels outils pratiques, quelles notions théoriques mobiliser pour les lire ? On s’attachera à dresser une cartographie de la production dramatique moderne et contemporaine ; à revenir sur les causes et les enjeux des « crises » qui ont affecté le texte dramatique au cours des XX e et XXI e siècles ; à montrer la diversité des réponses apportées par les auteurs aux mutations qui affectent le théâtre et le monde. Le séminaire s’appuiera également sur la programmation théâtrale de la saison et sur l’analyse des spectacles vus ensemble. Ce séminaire s’articulera avec l’atelier d’écriture donné au S1 (Intervenant.e et dates seront précisés à la rentrée). Validation : Assiduité etet « appropriation libre » d’un texte parmi les œuvres étudiées. |
|||||
|
Jeu et iconographie de l’acteur comique (2) |
|||||
|
Marion Chénetier-Alev |
MERCREDI 10H30 - 12H30 |
Salle Weil | 6 | S1 |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIER COURS : le 25 septembre 2024. Poursuivant la recherche entamée en 2023, le séminaire continuera sa traversée dans l’histoire et l’iconographie de l’acteur comique, mais, s’articulant avec l’atelier de jeu animé par Yvo Mentens, il mettra l’accent sur l’art du clown. De quels traces, images, documents, témoignages dispose-t-on pour retracer cette histoire ? Quelles informations ces images peuvent-elles livrer sur le style et les interprétations des acteurs, dans une approche archéologique du jeu qui recoupe les témoignages écrits ? Quelles ont été les grandes figures de clowns ? Comment a-t-il.elle évolué ? Et, en examinant le cas de quelques grand.e.s interprètes clowns contemporain.e.s, comment déconstruire les durables idées reçues sur cet art ? Validation : Assiduité et production d’une analyse de cas. |
|||||
|
L’héritage de la performance sur la scène contemporaine |
|||||
|
William Ravon |
MARDI 10H30 - 12H30 |
Salle Weil | 6 | S1 |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIER COURS : le 17 septembre 2024. Ce cours propose de poursuivre l’exploration d’une histoire de la performance à l’usage des études théâtrales. Bien qu’initiés majoritairement par des artistes issus du champ des arts plastiques, les « happening », « events » et « actions » du XXème siècle ont durablement influencé les artistes de la scène contemporaine (Romeo Castellucci, Angélica Liddell, Rébecca Chaillon, Steven Cohen, Carolina Bianchi, etc.). À travers un jeu d’allers-retours entre ces artistes plus contemporains et des figures emblématiques de la performance (John Cage, Allan Kaprow, Carolee Schneemann, Gina Pane, Laurie Anderson, etc.), nous étudierons comment la notion de « performatif » s’est peu à peu étendue au champ du spectacle vivant, autant pour désigner l’influence des arts plastiques à l’égard du théâtre, que pour décrire un certain devenir de la représentation théâtrale dans ses nouvelles modalités esthétiques. Validation : Exposé oral ou dossier écrit. |
|||||
|
Atelier des spectatrices et des spectateurs |
|||||
| Antoine Girard |
VENDREDI 9h30 - 12H30 |
Salle Weil | 6 | S1 | Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIER COURS : le 20 septembre 2024. À raison d’un spectacle par semaine, selon une sélection reflétant la diversité de la création théâtrale contemporaine présentée à Paris et dans sa proche banlieue, l’atelier des spectatrices et des spectateurs propose un temps d’échange et de réflexion collective. À chaque séance est discuté le spectacle vu la semaine précédente afin d’en déplier les enjeux formels, dramaturgiques, politiques et d’apprendre, collectivement, à regarder et à décrire la création théâtrale. Aucun prérequis à l’inscription, mais il est obligatoire de voir tous les spectacles et d’être présent·e à chaque séance. Validation : assiduité et participation orale. |
|||||
|
Séminaire de tutorat : actualité théâtrale et partage de la recherche. |
|||||
|
|
VENDREDI 16H - 18H |
Salle Weil | 3/S |
S1/S2 |
Tutorat |
|
PREMIER COURS : 27 septembre 2024. Séminaire obligatoire pour celles et ceux qui auront pour tuteur.ice Marion Chénetier-Alev ou Antoine Girard. Il s’agit, à raison d’une fois par mois, d’échanger autour des thèmes de recherche des tutoré·e·s, de partager leurs expériences de spectateur·ice·s et de dialoguer sur l’actualité de la création contemporaine dans ses enjeux multiples (esthétiques, institutionnels, politiques). Validation : assiduité et dossier. |
|||||
| Esthétique et philosophie de l’art | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
|
Actualités critiques en théorie des arts |
|||||
|
Alexis Anne-Braun |
JEUDI 9H30 - 12H30 |
Salle Weil | 6 | S1 | Réservé au Master PAT |
|
Cours obligatoire et réservé aux étudiants du Master PAT. Sous la forme d’un club de lecture, nous lirons ensemble des textes de parution récente permettant de penser le monde contemporain et les pratiques artistiques dans toutes leurs complexités : crise écologique, actualités du féminisme, du marxisme, des théories de la race et du genre, utopisme queer, décolonisation. Validation : Assiduité et préparation de deux exposés durant le semestre. |
|||||
| « Textes et Œuvres : discours sur l’art du XXe siècle » | |||||
| Katia Sowels et Alexis Anne-Braun |
MARDI
14H - 17H |
Salle Weil | 6/S | S1/S2 (sécables) |
Ouvert à tou.te.s |
|
CALENDRIER (S1) : 17 septembre ; 1er octobre ; 15 octobre ; 26 novembre ; 10 décembre ; 17 décembre. Ce séminaire proposera une traversée des grands classiques de l’histoire et de la théorie de l’art du XXe siècle. À raison de deux fois par mois, chaque séance sera consacrée à l’analyse d’une œuvre d’art à partir de la lecture collective d’un texte théorique et critique. Il s’agira de mettre en lumière la pluralité des approches méthodologiques, les croisements interdisciplinaires et l’évolution des courants de pensée de l’histoire de l’art contemporain, entre esthétique, histoire culturelle et sociale de l’art, études de genre, anthropologie de l’art, études matérielles, études visuelles, et philosophie de l’art. Validation : Participation orale. |
|||||
|
La philosophie à l’épreuve de l’art en France après 1945 |
|||||
|
Jules COLMART |
LUNDI 14H-16H |
Salle des Résitants |
6 |
S1 |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIÈRE SÉANCE : 16 septembre Ce cours a pour objet la philosophie de l’art française d’après-guerre. Plus précisément, nous y examinerons les questions suivantes : pourquoi la philosophie, et plus précisément la phénoménologie, s’empare à partir de cette période avec force d’un objet, l’œuvre d’art picturale ? Quels sont les enjeux internes à la philosophie qui justifient une telle focalisation ? Qu’est-ce que penser sur l’art et à partir de l’art ? Quelles différences entre l’approche philosophique de l’art et l’approche historique ? Quels effets en retour de l’art sur la philosophie et notamment sur la théorie du concept ? En examinant l’œuvre de trois philosophes français provenant de la phénoménologie (Deleuze, Lyotard, Maldiney, Merleau-Ponty), et en nous concentrant avant tout sur les arts visuels (au premier chef la peinture et le cinéma), nous verrons comment le recours à l’art répond à un besoin de renouvellement aussi bien de la philosophie du langage et de l’histoire que, plus fondamentalement, de l’ontologie et de la conception classique de la représentation. Nous verrons à partir de là comment, dans la lignée de la philosophie allemande du XIXème siècle, une certaine philosophie française a poursuivi le projet d’une fondation esthétique de la métaphysique. Bibliographie primaire indicative, qui sera complétée à la rentrée : |
|||||
|
L’œuvre d’art et le système. La philosophie de l’art chez Hegel et Schelling |
|||||
|
Alexandru DAVID et |
LUNDI 8H30-10H30 |
Salle des Résistants |
6 |
S1 |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIÈRE SÉANCE : 16 septembre Ce cours propose une introduction aux pensées esthétiques de l’idéalisme allemand, à travers une étude du Système de l’idéalisme transcendantal (1800) de Schelling et des leçons qu’il a données à Iéna et Würzbourg (1802-1805) sur la Philosophie de l’art, ainsi que des Cours d’esthétique donnés par Hegel à Berlin (1820-1829). L’esthétique devient avec Schelling et Hegel une science de l’art par son inclusion dans le système de la philosophie. C’est à ce titre qu’elle peut désormais, comme philosophie de l’art, articuler (à la différence des esthétiques de Baumgarten et de Kant qui prenaient pour point de départ l’état esthétique du spectateur) un sens philosophique de l’activité artistique, des catégories qui permettent de regrouper les œuvres sous des unités de compréhension, et des descriptions raisonnées d’œuvres historiques. Ils ont permis ainsi de poser de nouvelles questions pour l’époque, décisives pour les réflexions esthétiques et pour l’histoire de l’art des XIXe et XXe siècles : quelles conséquences l’insertion de l’art dans une perspective systématique a-t-elle pu avoir sur la compréhension du statut des œuvres et de leur expérience ? L’esthétique s’entend chez eux comme philosophie de l’art, et l’étude du beau comme étude du beau artistique ; la nature est-elle pour autant entièrement refoulée hors de l’art ? Quelle nécessité y a-t-il pour l’approche scientifique des œuvres d’art à prendre en considération leur historicité ? Et, sur la base de cette historicité, comment comprendre le rôle de l’œuvre d’art dans la compréhension de soi d’une communauté, à une époque donnée ? Une bibliographie sera donnée lors du premier cours. La connaissance de l’allemand n’est pas nécessaire. |
|||||
| Photographie | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
|
Génétique du photographique. Réemploi, assemblage, recyclage (3) |
|||||
| Aurèle Crasson (ITEM) et Delphine Desveaux (Collections Roger-Viollet et conservatrice à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris) |
UN JEUDI PAR MOIS 14H - 16H |
voir calendrier | 6 (au total) |
S1/S2 (insécables) |
Ouvert à tou.te.s |
|
Ce séminaire est ouvert aux mastériens des département Arts et Lettres de l’ENS et aux étudiants de PSL. Placé sous la responsabilité d’Aurèle Crasson (Directrice adjointe ITEM) et de Delphine Desveaux (Directrice des Collections Roger-Viollet / BHVP), ce séminaire entend lancer une réflexion autour de la matérialité du photographique, le « du » permettant d’éviter la confusion entre photographie et image, medium et sujet, support et procédé et de problématiser la notion d’œuvre. A l’ère du soi-disant tout numérique où de l’image toute puissante et envahissante est produite autant par des professionnels que par des amateurs, par des artistes que par des reporters, revenir sur la matérialité photographique (du choix du film au choix de la typologie de l’épreuve produite ou du choix de l’utilisation de « l’image » diffusée) permet de questionner les notions de processus à l’œuvre dans les travaux des photographes et de poser les conditions de leur analyse génétique. Un retour sur le pourquoi de l’invention du procédé et ses multiples déclinaisons depuis 1827 démontrera la variété du photographique et ses possibles si étendus et toujours comme en expansion, ayant mené à l’invention d’un langage photographique pratiqué aujourd’hui par tout à chacun ou presque. Le séminaire se déploiera autour de 8 séances – dont deux sous forme d’ateliers pratiques (tirage et composition) qui permettront de découvrir diverses techniques en laboratoire et d’aborder la question de "l’éditing". Il débutera par une présentation du séminaire, se poursuivra par une immersion dans l’histoire de la photographie avec une visite au musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône et accueillera aux séances suivantes, des photographes dont le travail illustre la thématique "remploi, assemblage, recyclage" choisie comme support de réflexion pour la troisième année universitaire consécutive (2024-2025). CALENDRIER : 17 OCTOBRE - 14h-16h30, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 21 NOVEMBRE (journée) - Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône (sur inscription, nombre limité de places) 19 DÉCEMBRE - 14h-16h, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 23 JANVIER 2024 - 14h-16h, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 20 MARS - 14h-16h, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 10 AVRIL - 14h-16h, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 22 MAI - 13h-18h, Laboratoire photo et salle Cavailles, 45 rue d’Ulm, 75005 (sur inscription, nombre limité de places). 5 JUIN - 10h-18h, Laboratoire photo et salle Dussane, 45 rue d’Ulm, 75005 (sur inscription, nombre limité de places). |
|||||