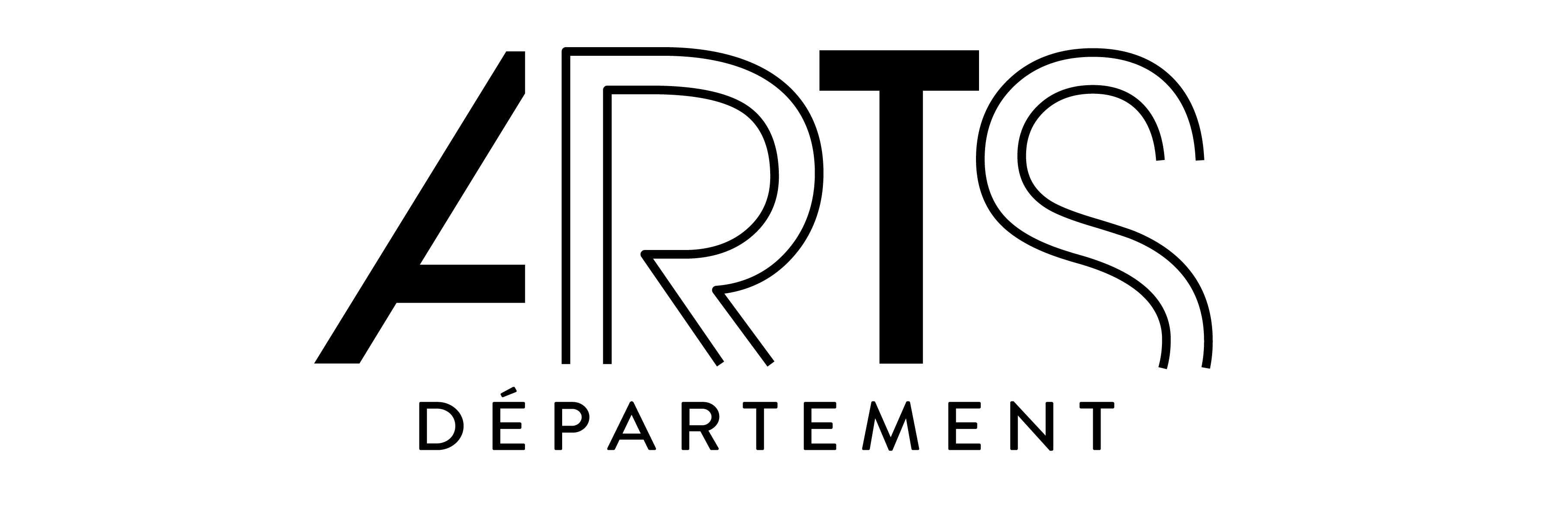S2 - Cours et séminaires par discipline 2024-2025

- Etudes cinématographiques
- Histoire de l’art
- Musique
- Etudes théâtrales et danse
- Esthétique et philosophie de l’art
- Photographie
|
|
|||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
| La Recherche-Création en cinéma, état des lieux | |||||
|
Antoine de Baecque |
JEUDI 10H30 - 12H30 |
salle des Actes sauf le 6/03/25 : salle BERTHIER) |
6 | S2 | Master et doctorat |
|
PREMIER COURS : le 30 janvier 2025 La rencontre entre recherche et création prend aujourd’hui de multiples formes. Pour les artistes comme pour les chercheurs, il parait essentiel de développer cette capacité à faire confiance aux outils de la création. Il est important, en outre, de placer la recherche-création au centre de questionnements politiques d’actualité, d’articuler ce mode de recherche avec les grandes remises en perspective contemporaines. La convergence entre les pratiques de recherche et artistique apporte d’autres manières de comprendre le monde et de le rendre sensible. On étudiera ce paradigme de la recherche-création à partir de certains films, vidéos et expériences filmiques récents. |
|||||
|
Deleuze et ses films |
|||||
|
|
UN LUNDI/MOIS 14H - 16H30 |
Amphi du Mûrier |
6 |
S1/S2 (insécables) |
Master et doctorat |
|
CALENDRIER : donné à la rentrée. Les deux volumes écrits par Gilles Deleuze, L’image-mouvement et L’image-temps, regorgent de films vus, de films aimés, de films décrits, de films tremplins vers les concepts, parfois les plus divers,intrigants, excentriques. Le philosophe fait feu de tout bois et celaprécisément car il est cinéphile, ayant vu beaucoup de films, s’appuyantsur leur analyse de détail. Ce séminaire propose une relecture desécrits de Deleuze via les films et leurs interprétations. |
|||||
|
La Critique. Séminaire de l’Institut d’Études Critiques |
|||||
|
Antoine de Baecque |
UN MERCREDI/MOIS 18H - 20H |
INHA 6 rue des Petits Champs 75002 |
6 |
S1/S2 |
Avancé |
|
Animé par Antoine de Baecque et programme d’invités à venir. Ce séminaire interdisciplinaire s’interroge sur les divers modes de l’écriture et de l’intervention critique, en France et à l’étranger. A travers l’étude de certaines personnalités, certaines revues ou journaux, certains lieux, certains courants de la critique cinématographique, on verra comment peut s’opérer de manière singulière et précise la transmission d’une expérience. |
|||||
|
Séminaire de tutorat : Actualité du cinéma |
|||||
|
Françoise Zamour et Antoine de Baecque |
JEUDI 13H - 15H |
Salle Weil | 6 | S1/S2 (insécables) |
Tutorat |
|
CALENDRIER : 16 janvier, 13 février, 13 mars, 15 mai et 12 juin (salle à confirmer). Réservé aux élèves et étudiants inscrits en cinéma (inscription principale ou secondaire), ou dont les travaux de recherche concernent le cinéma. Validation : participation assidue et active à toutes les séances. Animation d’au moins une discussion par semestre. |
|||||
|
Une histoire cinématographique de l’Italie contemporaine (1945-1978) |
|||||
|
Mathieu Combe |
LUNDI 16h - 18h |
Salle Weil | 6 | S2 | Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIERE SEANCE : le 20 janvier 2025. Le cinéma italien, à partir de sa refondation esthétique dans le néoréalisme de l’après- guerre, fut gouverné par une idée centrale : s’inscrire au cœur des bouleversements de son époque, se faire le témoin privilégié de l’histoire. De Rome ville ouverte à Cadavres exquis, d’Umberto D. à Todo Modo, nombre des chefs-d’œuvre de l’âge d’or de la cinématographie transalpine se confrontèrent de plein fouet à leur temps et se mirent face au devenir incertain d’une démocratie aux prises avec les soubresauts de la modernité. Dans ce cours, on considérera, de la Libération à la crise des "années de plomb", les trente ans de cinéma italien issus du néoréalisme, à la recherche des formes cinématographiques qui surent en perpétuer la vocation originaire d’écriture de l’histoire. Validation : Dossier écrit ou validation orale. |
|||||
|
ANNULÉ : Masculinités du cinéma classique |
|||||
|
Françoise Zamour |
VENDREDI 14H - 16H |
Salle Langevin | 6 | S2 | Ouvert à tou.te.s |
|
|
|||||
| Histoire de l’art | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
| Création collective – (années 1970-2000) | |||||
|
Katia Sowels |
MARDI 8H30 - 10H30 |
Salle des Actes |
6 |
S2 |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIER COURS : le 21 janvier 2025. Ce séminaire, entrepris en 2023, est ouvert à toutes et à tous sans prérequis. Il prend le contre-pied d’une histoire de l’art centrée sur les noms d’artistes et les approches monographiques, en proposant une introduction à l’art des XXe et XXIe siècles sous l’angle de la création collective. Cordées, couples, duos, amitiés, groupes, associations ou collectifs d’artistes, nous permettent d’y interroger le renouvellement du statut des œuvres d’art et de leurs auteurs, récusant la mythologie de l’artiste solitaire et les carrières individuelles au profit de communautés de création et d’engagement. À partir d’un corpus ne visant pas à l’exhaustivité, on s’attache aux conditions et aux processus des œuvres faites à plusieurs, ainsi qu’aux espaces de sociabilité favorables à la mise en commun des pratiques et à l’union des artistes (professionnels ou non), tout en tâchant de faire la part entre l’art collectif, l’art collaboratif, l’art anonyme, l’art relationnel ou encore l’art participatif. Ce semestre prendra le relais chronologique et thématique des éditions précédentes, en se concentrant sur l’art des années 1970 à nos jours. Dans des contextes artistiques, sociaux- économiques, politiques renouvelés, et dans un espace mondialisé, on s’intéressera aussi bien aux formes et aux structures de la création collective (collectifs d’artistes, « community-based art », factory-studios, etc.) qu’à des initiatives plus spontanées ou ponctuelles. Validation : mini-mémoire. |
|||||
|
Art et Empire. Les imaginaires coloniaux en France, 1700-1850 |
|||||
|
Charlotte Guichard |
MARDI 10H30 - 12H30 |
Salle des Actes | 6 |
S2 |
Master/ Doctorat |
|
PREMIER COURS : le 21 janvier 2025. Ce séminaire de recherche portera sur les cultures visuelles et artistiques de l’Empire français, au moment de sa première expansion (jusqu’en 1763, en Inde et en Amérique du Nord), puis au moment de sa redéfinition au début du dix-neuvième siècle avec les tentatives de colonisation de l’Egypte et puis celle de l’Algérie. Il articulera l’histoire de l’empire et de la conquête coloniale aux matériaux visuels, artistiques, artefactuels qui en témoignent. Ce séminaire sera aussi un lieu de discussion des nouveaux travaux en histoire de l’art moderne dans un paysage historiographique international en plein renouvellement sur ces questions. Validation : assiduité, participation, note de lecture. |
|||||
|
Le dessin à l’œuvre, XVIIe-XVIIIe siècles |
|||||
|
Charlotte Guichard |
MERCREDI 10H30 - 12H30 |
Conf46 |
6 | S2 | Initiation et Avancé. Ouvert au Programme gradué ARTS. |
|
PREMIER COURS : le 22 janvier 2025. Places limitées (15) - inscription préalable obligatoire auprès de l’enseignante. Charlotte Guichard confirmera par mail l’inscription courant janvier, avant le premier cours. Ce séminaire interroge le rôle essentiel du dessin dans la création à l’époque moderne, dans les beaux-arts, mais aussi dans les arts décoratifs ou appliqués- les « arts du dessin », comme on les appelle au XVIII e siècle. Trois questions centrales seront abordées : les apprentissages académiques, les usages du dessin (esthétiques, techniques et scientifiques ou cognitifs) et enfin les spécificités matérielles du médium (avec ses qualités d’adaptabilité, de portabilité, de plasticité). Envisagé comme un médium pluriel, le dessin participe pleinement à la modernité en raison de ses liens avec l’industrie et la manufacture, mais aussi de son rôle dans l’expansion européenne à l’époque moderne qui fait une place centrale au dessin naturaliste. Certaines séances, de 3h, auront lieu dans les collections muséales parisiennes et dans les institutions de PSL. Validation : assiduité, participation, mini-mémoire autour d’une œuvre. |
|||||
|
Séminaire de Tutorat |
|||||
|
Charlotte Guichard |
UN MARDI/MOIS 14H30 - 16H30 |
Salle Weil |
6/S |
S1/S2 |
Tutorat/ |
|
CALENDRIER (S2) : 21 janvier, 11 février, 11 mars, 1er et 29 avril 2025. Ce séminaire est réservé aux étudiant·es spécialistes d’histoire de l’art pour lesquels il est obligatoire. On y alternera lectures de textes, questions d’actualité, et enfin, pour les étudiant·es concernés, une préparation aux épreuves de l’INP. Les étudiant·es sont appelés à se saisir de ces séances, c’est-à-dire à y parler, débattre autour de sujets proposés en début de semestre. Validation : La validation du cours dépend de la participation effective de chaque étudiant·e. |
|||||
|
Séminaire Autochtonie, hybridité, anthropophagie (5) |
|||||
|
Morgan Labar et |
UN MERCREDI 17H - 19H30 |
voir calendrier ci-dessous |
3 | S1/S2 (insécables) |
Ouvert à tou.te.s |
|
CALENDRIER S2 : Cette année le séminaire poursuit l’étude des arts contemporains autochtones en contexte globalisé. Les termes « autochtonie », « hybridité » et « anthropophagie » (en référence au Manifeste Anthropophage d’Oswald de Andrade publié en 1928) sont accolés afin de questionner les assignations identitaires et les essentialismes, et d’interroger l’invention de pratiques et d’identités fluides, déjouant les catégories héritées du colonialisme et permettant de repenser les rapports à la nature, au territoire, aux autres humains et aux autres qu’humains. Validation : participation et présentation orale d’un article ou chapitre d’ouvrage. |
|||||
|
Structuralisme et esthétiques du terrestre |
|||||
|
Patrice Maniglier (Nanterre) et Jeanne Etelain (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier) |
MERCREDI 18H - 20H |
Salle Weil / INHA |
6 |
S1/S2 |
Ouvert à tou.te.s |
|
CALENDRIER : Le structuralisme a sa place dans notre situation intellectuelle, non pas comme héritage passif, mais fait récurrent dont l’énigme mérite d’être interrogée encore de nos jours. Il s’agit d’explorer toutes les ressources et potentialités actuelles du structuralisme, notamment dans les domaines esthétiques et artistiques, en rapport avec notre "présent terrestre". |
|||||
| Musique | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
|
Introduction à l’histoire de la musique par l’écoute des œuvres |
|||||
|
Karol Beffa |
MERCREDI 17H - 19H |
Salle des ACTES Sauf le 5 mars 2025 : Salle Conférence 46 (46, rue d’Ulm) |
6/S | S1/S2 (sécables) |
Initiation/ avancé |
|
PREMIERE SEANCE : le 22 janvier 2025. Ce séminaire est ouvert aussi bien aux non-spécialistes, donc aux étudiants et élèves de première année, qu’aux spécialistes, plus avancés dans leurs études. La période étudiée va de Bach à nos jours. Il s’agira essentiellement de musique occidentale savante, mais il sera fait ponctuellement référence à des musiques extra-européennes. Il constitue par ailleurs une préparation à l’épreuve de commentaire d’écoute du concours d’entrée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en classes d’érudition (esthétique, culture musicale, analyse, histoire de la musique). Validation : participation et exposé. |
|||||
| Adorno et la poésie : la langue et le chant | |||||
|
Fériel Kaddour |
JEUDI 14H - 17H |
Salle Conférence 46 | 6 |
S2 |
Initiation/ |
|
PREMIER COURS : le 23 janvier 2025. Pré-requis : Séminaire ouvert à toutes et tous, il n’est pas nécessaire de savoir lire une partition pour le suivre. Validation : mini-mémoire. 6 ects. |
|||||
|
Perspectives musicologiques |
|||||
|
Fériel Kaddour |
JEUDI 18H -19H30 |
Salle Musique 46 | 6/S | S1/S2 (sécables) |
Initiation/ avancé |
|
PREMIERE SEANCE : le 23 janvier 2025. Qu’est-ce que la recherche en musicologie ? La discipline est diverse et se prête à des méthodes de travail contrastées. Ce séminaire tentera d’en offrir un panorama aussi large que possible, en s’ouvrant notamment à des questions et des répertoires peu abordés par les autres enseignements musicologiques du Département (musique ancienne, musiques actuelles, histoire des institutions culturelles, sound studies, etc.). Certaines séances seront consacrées à des questions spécifiques de méthode. Elles sont vivement recommandées aux étudiant.e.s de Master. Validation : mini-mémoire. Les travaux de validation sont à rendre au plus tard le 15 juin. |
|||||
|
L’idée de nature dans le Lied romantique allemand |
|||||
|
Fériel Kaddour |
du 3 au 7 mars 2025 |
STAGE DÉLOCALISÉ à Bois-Guilbert (Normandie) |
6 |
S2 |
Initiation/ |
|
INSCRIPTION : Le nombre de places est limité : s’adresser à feriel.kaddour@ens.fr pour solliciter une inscription. Le poète marchant par les sentiers forestiers : telle semble être la posture convenue du Lied romantique (et post-romantique) allemand. C’est cette posture qu’il s’agira d’interroger, en travaillant sur quelques œuvres centrales de ce répertoire (Schubert, Schumann, Mahler). La spécificité du séminaire tient à ses approches pluridisciplinaires. Même si la musique sert de fil conducteur au travail, il n’est pas impératif de savoir lire une partition pour s’y inscrire. Les travaux de recherche seront répartis par groupes pluridisciplinaires : toutes les compétences, théoriques et artistiques, y sont les bienvenues ! Calendrier : Pré-requis : il n’est pas nécessaire de savoir lire une partition pour suivre ce séminaire. Les apports venus des autres arts sont bienvenus. |
|||||
|
"Divas and Scholars" : Anglophone literature on voice |
|||||
|
Cassandra Windey |
MARDI 15H30-1830 (8 séances, |
Salle Musique 46 |
6 |
S2 |
Initiation/ |
|
CALENDRIER : 21 et 28 janvier, 4 et 11 février, 18 février ou 11 mars (à confirmer), 18 et 25 mars, 1er avril. The purpose of this seminar is to explore current trends in anglophone scholarship on voice, particularly focused on opera. Differences between operatic singing and other modes of vocal performance stem not only from the specificities of a technique but also from the meaning ascribed to "the operatic utterance" (Grover-Friedlander). As we explore the literature on this subject, we will seek to understand the relation between body and voice that is mobilised in operatic singing. Using the idea of the materiality of the operatic voice as a guiding thread, we will consider, among other things, scholarly debates on the meaning of operatic singing ; the notion of bodily presence in the operatic voice ; and the relevance of performativity for opera. Selected readings : |
|||||
|
L’interprétation musicale : pratique et théorie |
|||||
|
Fériel Kaddour |
VENDREDI 14H - 18H |
Salle Conférence 46 | 6 | S1/S2 (insécables) |
Initiation/ avancé |
|
PREMIERE SEANCE : vendredi 27 septembre 2024. Ce séminaire propose d’allier pratique et théorie, et plus encore de réfléchir aux apports possibles de la recherche-création dans le domaine musical. Chaque séance sera consacrée à deux œuvres (même effectif, même type formel ou même période de composition), qui seront jouées par des étudiant.e.s. et qui donneront lieu à un cours d’interprétation. Le travail mené à l’instrument sera l’occasion d’une analyse approfondie des partitions, ainsi que d’une réflexion plus générale sur l’interprétation musicale. Les œuvres des deux premières séances seront jouées par d’ancien.ne.s élèves du Département. Les séances suivantes seront consacrées aux propositions des participant.e.s du séminaire. Il n’est cependant pas nécessaire de contribuer musicalement au séminaire pour s’y inscrire : les cours d’interprétation s’organiseront en fonction des propositions des participant.e.s. Pré-requis : lecture d’une partition. |
|||||
|
Introduction à l’orchestration |
|||||
|
Karol Beffa |
MERCREDI 14H30 - 16H30 |
Salle Musique 46 | 6 | S2 | Avancé |
|
PREMIERE SEANCE : le 22 janvier 2025. Ce cours propose un aperçu de l’histoire de l’orchestration, depuis l’orchestre classique jusqu’à l’orchestre romantique et moderne. Il cherche à faire acquérir aux étudiants une connaissance des particularités des différents instruments, afin qu’ils arrivent à une meilleure maîtrise de l’écriture pour diverses formations, de la musique de chambre au grand orchestre : une partie du cours précise, grâce à l’analyse, la fonction de chaque instrument dans l’ensemble ; une autre partie aide les étudiants à se familiariser avec l’écriture pour cordes ou pour vents. |
|||||
|
Musicologie pour spécialistes |
|||||
|
Fériel Kaddour |
VENDREDI 9H30 - 12H30 |
Salle Conférence |
6/S |
S1/S2 |
Avancé |
|
Réservé en priorité aux musicologues spécialistes, ce séminaire a pour but l’acquisition d’une connaissance tant technique qu’esthétique des styles « classique » (Mozart, Haydn, Beethoven) et « romantique » (Schubert, Schumann, Chopin). Il s’ouvre ponctuellement à d’autres répertoires, ainsi qu’à des problématiques issues de la théorie critique (Adorno) et de la New Musicology. Ce séminaire est également ouvert aux étudiant.e.s spécialistes d’autres disciplines qui souhaitent intégrer la musicologie dans leur parcours d’études. Pré-requis : très bon niveau de solfège et bases solides d’analyse musicale. Validation : contrôle continu (exercices d’analyse harmonique et commentaires sur partition). |
|||||
| Etudes théâtrales et danse | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
|
|
|||||
|
Marion Chénetier-Alev |
MERCREDI 9H30 - 12H30 |
Salle Weil | 6 | S2 |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIER COURS : le 22 janvier 2025. Ce séminaire questionne la réception des pièces chorégraphiques et ce qu’elles présupposent quant aux définitions de l’œuvre chorégraphique et de la danse elle-même, ainsi que les différents angles critiques qui s’offrent à qui veut rendre compte d’un spectacle de danse. Il accueille des interventions de critiques et de spécialistes des notations en danse, et couvre essentiellement les productions chorégraphiques françaises et étrangères depuis 1980. Les étudiants seront amenés à produire des textes critiques à partir des spectacles issus de la programmation danse 2024-2025. Nota Bene : L’inscription à ce séminaire ne requiert pas d’avoir une pratique ou une connaissance préalable de la danse. Validation : Assiduité et production critique. |
|||||
|
Théâtre et médias : La création radiophonique contemporaine |
|||||
|
Marion Chénetier-Alev |
VENDREDI 9H30 - 12H30 |
Salle Weil | 6 | S2 | Avancé |
|
PREMIER COURS : le 31 janvier 2025. Ce séminaire poursuivra la découverte, l’étude et la pratique des créations radiophoniques contemporaines en interrogeant l’évolution entre les formes créées par les grands réalisateurs de la fin du XXe et du début du XXIe, et les productions sonores actuelles auxquelles les nouvelles pratiques de l’écoute (podcasts, plateformes audio, festivals de l’écoute) offrent un champ de réinvention possible. L’accent sera mis sur les outils à concevoir pour analyser les compositions sonores. Le travail reposera sur l’écoute intensive des œuvres, incluera une pratique du logiciel Reaper et une production sonore personnelle ou collective, en collaboration avec le créateur sonore David Christoffel. Validation : Assiduité et analyse ou production d’une œuvre radiophonique. |
|||||
|
Lecture et dramaturgie du texte théâtral : La Cerisaie, La Mouette, |
|||||
|
Antoine Girard |
VENDREDI 13H30 - 16H |
Salle Weil | 6 | S2 | Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIER COURS : le 24 janvier 2025. En s’appuyant sur deux pièces majeures de Tchekhov, présentées cette année dans la saison théâtrale parisienne, il s’agit de s’initier à la fois à la théorie de la dramaturgie et à ses différentes applications pratiques. On confrontera une analyse précise des deux textes, menée collectivement, aux nombreux exemples de mises en scène qu’elles ont suscités. Il s’agira d’explorer les virtualités de ces deux pièces, pour comprendre l’évolution de leurs traductions scéniques au cours de l’histoire récente du théâtre autant que pour saisir la façon dont elles résonnent avec le monde contemporain et continuent de nourrir la création théâtrale (voire cinématographique) actuelle. Prérequis : Au S1, il est fortement suggéré d’aller voir Sur l’autre rive, mise en scène Cyril Teste, au Théâtre Nanterre Amandiers (du 27 septembre au 13 octobre) et La Mouette, mise en scène de Stéphane Braunschweig au Théâtre de l’Odéon (novembre-décembre 2024). Un contingent de places est prévu pour ces deux spectacles, si vous êtes intéressés par le séminaire, signalez-le au plus tôt à l’adresse girardantoine@pm.me Validation : Assiduité, présentation orale ou dossier. |
|||||
|
Séminaire de tutorat : actualité théâtrale et partage de la recherche |
|||||
|
Marion Chénetier-Alev |
UN VENDREDI 16H - 18H |
Salle Weil | 3/S |
S1/S2 |
Ouvert à tou.te.s |
|
CALENDRIER (S2) : 24 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril et 2 mai. Séminaire obligatoire pour celles et ceux qui auront pour tuteur.ice Marion Chénetier-Alev ou Antoine Girard. Il s’agit, à raison d’une fois par mois, d’échanger autour des thèmes de recherche des tutoré·e·s, de partager leurs expériences de spectateur·ice·s et de dialoguer sur l’actualité de la création contemporaine dans ses enjeux multiples (esthétiques, institutionnels, politiques). Validation : assiduité et dossier. |
|||||
|
Spectacles phares (2) |
|||||
|
Anne-Françoise Benhamou, |
LUNDI 10H - 13H |
Salle Weil | 6 | S2 | Avancé |
|
PREMIERE SEANCE : lundi 27 janvier 2025. Certains spectacles réputés majeurs sont régulièrement évoqués dans l’histoire de la scène des XXe et XXIe siècles. Pour la deuxième année, et avec un corpus différent, il s’agira ici de revenir, le plus précisément possible, sur quelques-uns de ces « phares » de la mise en scène, à raison d’un spectacle par séance, et, en connaissance de leur histoire, de les discuter au présent : comment peut-on les regarder d’aujourd’hui ? Que comprend-on ou ne comprend-on pas dans une vidéo, dans une archive ? Qu’y voit-on de différent de leur mythe ? Quel usage faire de traces parfois si minimes ? Ce séminaire à trois voix et à deux générations de spectatrices alternera des spectacles présentés par des archives (notamment captations vidéo) et des spectacles de la saison réalisés par des artistes ayant marqué l’histoire de la scène. Validation : Assiduité, participation orale, compte rendu final. |
|||||
| Esthétique et philosophie de l’art | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
|
Technology and the arts |
|||||
|
Lydia Goehr |
les 7, 14, 21 et 28 mai, de 16h à 18h |
Salle des Actes | 6 | S2 | Ouvert à tou.te.s/ Séminaire en anglais |
|
The course will investigate the place of technology in philosophical theory and the arts. The range of the readings will extend from circa 1900 to the present. Technology is both highly condemned for limiting human experience and highly celebrated for its expansion of human and social possibilities. |
|||||
|
« Textes et Œuvres : discours sur l’art du XXe siècle » |
|||||
|
Katia Sowels et |
MARDI 14H - 17H |
Salle Weil | 6 | S1/S2 (sécables) |
Ouvert à tou.te.s |
|
CALENDRIER (S2) : 28 janvier ; 4 février ; 18 février ; 4 mars ; 18 mars ; 25 mars. Ce séminaire proposera une traversée des grands classiques de l’histoire et de la théorie de l’art du XXe siècle. À raison de deux fois par mois, chaque séance sera consacrée à l’analyse d’une œuvre d’art à partir de la lecture collective d’un texte théorique et critique. Il s’agira de mettre en lumière la pluralité des approches méthodologiques, les croisements interdisciplinaires et l’évolution des courants de pensée de l’histoire de l’art contemporain, entre esthétique, histoire culturelle et sociale de l’art, études de genre, anthropologie de l’art, études matérielles, études visuelles, et philosophie de l’art. Validation : Participation orale. |
|||||
|
Théories contemporaines de l’image et de l’imagination |
|||||
|
Alexis Anne-Braun |
MARDI 10H30 - 12H30 |
Salle des Résistants | 6 | S2 | Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIERE SEANCE : 21 janvier 2025. Ce cours proposera une introduction aux théories de la dépiction, de l’imagination et de la représentation iconique qui ont été élaborées et discutées dans la philosophie anglo-américaine de la seconde moitié du XXème siècle. Seront présentés et explicités différents problèmes et enjeux constitutifs de cette littérature : la question du réalisme des représentations, la thèse de la naturalité des images, l’opposition texte/image, les notions d’illusion, d’imagination, de faire-semblance et de ressemblance. Il s’agira aussi de réfléchir aux rapports qui se sont noués à partir des années 1960 entre psychologie de la perception, histoire de l’art et philosophie. |
|||||
|
L’esthétique comme aisthétique : histoire et enjeux philosophiques |
|||||
|
Mildred GALLAND-SZYMKOWIAK |
MERCREDI 16H-18H |
Salle des Résitants |
6 |
S2 |
Ouvert à tou.te.s |
|
En explorant les contributions majeures apportées depuis le 18e s. à la compréhension de l’esthétique comme une aisthétique, c’est-à-dire comme science du beau et/ou de l’art qui les rapporte à une étude de la sensation, de la perception et des sentiments, ce cours a pour but de construire l’une des histoires philosophiques possibles de l’esthétique, en même temps que d’éclairer des questions contemporaines. Une telle histoire débute avec Baumgarten et Herder et se transforme avec Kant ; elle se poursuit autour de 1900 à partir des perspectives ouvertes par la psychologie, expérimentale (G. Fechner) ou introspective (T. Lipps), qui nourrissent la théorie de l’histoire de l’art (H. Wölfflin, A. Schmarsow, W. Worringer) ; elle est alimentée plus tard par des approches phénoménologiques (M. Merleau-Ponty, H. Maldiney). Enfin l’esthétique/aisthétique s’est récemment retrouvée centrale aussi bien pour la réélaboration de l’esthétique à partir de la notion d’atmosphère (G. Böhme), que dans une tentative de synthèse issue de la philosophie analytique (B. Nanay). Le cours introduira à ces pensées, avec des exemples et en suivant le fil de plusieurs questions : quelle différence entre une perspective philosophique et une perspective scientifique sur la sensation ? Quel est l’effet-retour d’une aisthétique sur la philosophie et son autodéfinition ? Une esthétique de l’aisthesis a-t-elle les moyens d’élucider les phénomènes de signification ? Est-elle cantonnée à l’immanence du sentir et à l’anhistoricité ? Quelles structures du percevoir et du sentir met-elle en évidence ? Quel rapport entre forme de l’œuvre et vécu affectif ? Comment décrire ce dernier au-delà du binôme plaisir/déplaisir ? |
|||||
|
Sensus communis : la constitution esthétique du politique |
|||||
|
Jules COLMART |
LUNDI 16H-18H |
Salle des Résitants |
6 |
S2 |
Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIÈRE SÉANCE : 20 janvier 2025 Quelle est la part de la sensibilité et de l’esthétique dans le politique ? En quoi la culture et sa valeur normative (le Beau) participe-t-elle de la recherche du Bien en politique ? Avec le renouvellement des théories du sens commun comme faculté fondatrice de l’espace public voire du jugement en vue de l’action politique à l’époque des Lumières (Thomas Reid, Emmanuel Kant) s’est ouverte la question de la part de la sensibilité, de l’imagination et du goût dans la constitution d’un espace commun d’action politique, et d’une “éducation esthétique” de l’homme en vue de sa réalisation morale et politique (Friedrich Schiller). Ce cours commencera par retracer les fondements du moment fondateur des Lumières, où l’esthétique, loin de se constituer de façon autonome, a été pensée au cœur du projet d’émancipation morale et politique de l’homme. Mais que vaut la réalité d’une communauté seulement posée en droit par le jugement de goût, voire comme utopie et promesse ? Quelle est la réalité du sens commun et de sa part prise au projet démocratique moderne ? L’égalité idéale du jugement de goût peut-elle connaître une effectivité politique réelle ? Passant au XXe siècle, nous verrons alors comment s’est renouvelé autour de cette notion de sens commun et de jugement de goût le débat autour des conditions de possibilité d’un monde commun, notamment chez Hannah Arendt et Jürgen Habermas, mais aussi dans les critiques matérialistes du sens commun, que ce soit chez Walter Benjamin, ou Pierre Bourdieu. Les dernières séances du cours seront alors consacrées à l’étude de la possibilité d’un renouvellement du concept de sens commun par Jacques Rancière, sous la forme d’un “partage du sensible”. Bibliographie indicative : |
|||||
|
L’art comme expérience de John Dewey, 90 ans après |
|||||
|
Mathias GIREL |
MARDI 14H-16H |
Salle des Résitants | 6 | S2 | Ouvert à tou.te.s |
|
PREMIÈRE SÉANCE : 21 janvier 2025 Cette année, nous nous engagerons dans la lecture de l’Art comme expérience, de John Dewey, initialement paru en 1934. Ce livre a eu une postérité bien au-delà du champ de l’esthétique et du pragmatisme. Le cours est construit comme suit : nous commentons un extrait de chacun des dix chapitres, et certaines séances accueilleront en outre des spécialistes internationalement reconnus de cet ouvrage ; ils nous exposeront leur propre regard sur l’extrait du jour. |
|||||
|
KUNST – Théories allemandes de l’art |
|||||
|
Mildred GALLAND-SZYMKOWIAK et Isabelle KALINOWSKI |
Sur 2 journées d’étude voir calendrier ci-dessous |
voir ci-dessous |
3 | S2 |
Ouvert à tou.te.s |
|
Le séminaire KUNST, séminaire interdisciplinaire d’esthétique et histoire de l’art, reprend ses activités au second semestre. Elle auront lieu cette année durant deux journées d’études (associées aux activités du réseau Semperiana) : Le jeudi 6 février 2025 : une journée sur "La forme" (interventions de Anatole Divoux, Danièle Cohn, Rémi Mermet, Victoria Griborenko et Jules Colmart) Salle Lettres 3 (2e étage, « couloir jaune ») de 9h à 18h Le mercredi 14 mai 2025 : une journée sur "Les pierres, de Goethe aux météorites"(interventions prévues de Arnaud Dubois, Letizia Giannela, Kai Wolner-Pratt, Romane Le Roux, Manon Gille, Estelle Thibault et Isabelle Kalinowski)
Ce séminaire s’adresse principalement aux étudiants avancés désireux de mieux connaître la pensée esthétique développée depuis le XVIIIe s., particulièrement en langue allemande, que ce soit par des philosophes, des historiens d’art ou des artistes et architectes, et qu’il s’agisse d’auteurs classiques ou moins connus.
Tous les étudiant(e)s sont les bienvenus. Le séminaire intéressera particulièrement les étudiants en arts et théorie des arts, en philosophie, en histoire de l’art, et en études germaniques. Une validation est possible : elle a pour condition la présence aux deux journées entières, et la remise d’un compte rendu des exposés et discussions d’une demi-journée. (3 ECTS)
|
|||||
|
Art, Création, Cognition |
|||||
|
Programme du séminaire : 6 FEVRIER - Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 16h. 6 MARS - Salle Marbo, 29 rue d’Ulm, 2ème étage, 16h. 13 MARS - Salle de Conférences 46 rue d’Ulm, 17h à 20h. 20 MARS - Salle Marbo, 29 rue d’Ulm, 16h. 27 MARS - Salle Marbo, 29 rue d’Ulm, 16h. 3 AVRIL : Salle Marbo, 29 rue d’Ulm, 16h. 10 AVRIL : Salle Marbo, 29 rue d’Ulm, 16h. contacts : claude.imbert@ens.fr ; segolene.lemen@gmail.com ; annesophie.aguilar@gmail.com ; |
|||||
| Photographie | |||||
| Enseignant.e.s | Horaires | Salle | ECTS | Semestre | Niveau |
|
Séminaire annuel de l’ITEM |
|||||
| Aurèle Crasson (ITEM) et Delphine Desveaux (Collections Roger-Viollet et conservatrice à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris) |
UN JEUDI PAR MOIS 14H - 16H |
voir calendrier | 6 (au total) |
S1/S2 (insécables) |
Ouvert à tou.te.s |
|
Placé sous la responsabilité d’Aurèle Crasson (Directrice adjointe ITEM) et de Delphine Desveaux (Directrice des Collections Roger-Viollet / BHVP), ce séminaire entend lancer une réflexion autour de la matérialité du photographique, le « du » permettant d’éviter la confusion entre photographie et image, medium et sujet, support et procédé et de problématiser la notion d’œuvre. A l’ère du soi-disant tout numérique où de l’image toute puissante et envahissante est produite autant par des professionnels que par des amateurs, par des artistes que par des reporters, revenir sur la matérialité photographique (du choix du film au choix de la typologie de l’épreuve produite ou du choix de l’utilisation de « l’image » diffusée) permet de questionner les notions de processus à l’œuvre dans les travaux des photographes et de poser les conditions de leur analyse génétique. Un retour sur le pourquoi de l’invention du procédé et ses multiples déclinaisons depuis 1827 démontrera la variété du photographique et ses possibles si étendus et toujours comme en expansion, ayant mené à l’invention d’un langage photographique pratiqué aujourd’hui par tout à chacun ou presque. Le séminaire se déploiera autour de 8 séances – dont deux sous forme d’ateliers pratiques (tirage et composition) qui permettront de découvrir diverses techniques en laboratoire et d’aborder la question de "l’éditing". Il débutera par une présentation du séminaire, se poursuivra par une immersion dans l’histoire de la photographie avec une visite au musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône et accueillera aux séances suivantes, des photographes dont le travail illustre la thématique "remploi, assemblage, recyclage" choisie comme support de réflexion pour la troisième année universitaire consécutive (2024-2025). CALENDRIER : 17 OCTOBRE - 14h-16h30, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 21 NOVEMBRE (journée) - Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône (sur inscription, nombre limité de places) 19 DÉCEMBRE - 14h-16h, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 23 JANVIER 2024 - 14h-16h, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 20 MARS - 14h-16h, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 10 AVRIL - 14h-16h, Salle des Actes, 45 rue d’Ulm, 75005. 22 MAI - 13h-18h, Laboratoire photo et salle Cavailles, 45 rue d’Ulm, 75005 (sur inscription, nombre limité de places). 5 JUIN - 10h-18h, Laboratoire photo et salle Dussane, 45 rue d’Ulm, 75005 (sur inscription, nombre limité de places). |
|||||